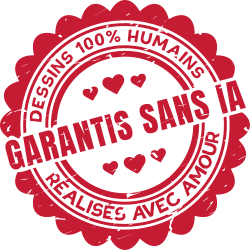J'veux du soleil : documenter la beauté des gens dans un monde hideux
J’ai eu la chance d’assister à une avant-première de J’veux du soleil, le dernier film de Gilles Perret et François Ruffin sur les gilets jaunes. C’était à Beaulieu-sur-Mer, le dimanche 17 mars, en présence de Ruffin venu « débriefer » le film à la fin.

J’avais adoré La sociale de Perret et bien sûr Merci Patron ! de Ruffin (grâce auquel j’avais justement découvert le futur député et très vite pris mon abonnement à Fakir que je n’ai plus quitté depuis) et je dois dire en toute honnêteté que je m’attendais à moins bien sur ce nouveau film : un film fait dans l’urgence, tourné en 6 jours et monté en quelques semaines… je m’attendais à un gros reportage un peu à l’arrache, une sorte de roman-photo de souvenirs pour la France des gilets jaunes. Un tract-vidéo sympa, mais sans plus. Eh bien c’est en réalité bien mieux que ça.
Les réalisateurs avaient fait le pari de documenter les gilets jaunes « avec » eux, et non contre eux, de ne pas laisser l’histoire s’écrire uniquement par les médias d’information continue (BFM et cie) accrocs aux faits divers et images-chocs. À la subjectivité bourgeoise pro-Macron maquillée en objectivité (quasi-généralisée dans ces grands médias), Perret et Ruffin opposent une subjectivité populaire assumée et, de ce point de vue là, le pari est réussi. À l’impossibilité de l’objectivité, ils ont préféré l’honnêteté : ils ont bien fait.
Là où le film dépasse les espérances, c’est sur sa forme : le principal risque était de virer au micro-trottoir d’une heure et demie, risque très vite désamorcé par la bonne idée de ne pas se limiter à quelques paroles échangées au détour d’un rond-point, et au contraire d’aller chez les gens, de poursuivre le dialogue, de l’approfondir. De parler avec eux, au calme, longtemps – on imagine assez aisément que les dix minutes assez denses que dure telle ou telle séquence centrée sur une personne sont le fruit d’un montage d’une bien plus longue discussion.
Le micro-trottoir souffre de deux lacunes : d’abord, il se compose des paroles courtes et sur le vif, il est donc fondamentalement superficiel ; ensuite, il ne donne la parole qu’à un nombre dérisoire d’individus, il est donc fondamentalement non-représentatif, et cela même si l’on met de coté les inévitables biais dans les questions et les réponses retenues (Guillaume Meurice est passé maître dans l’art de détourner le micro-trottoir en en retenant le pire à des fins satiriques). Le film ne se prétend jamais représentatif (à raison), mission impossible en un temps si restreint et avec si peu de moyens ; il peut néanmoins se targuer de ne pas rester en surface, de creuser ces différentes histoires humaines – toujours dures, souvent dramatiques – afin qu’il n’en reste pas qu’une succession de phrases et de déclarations à l’emporte-pièce. On regarde, on écoute, on apprend ces histoires, on se les prend parfois en pleine gueule : oui, en 2019, en France, certains ne mangent pas tous les jours ; oui, en 2019, en France, certains ont un boulot et vivent dans une caravane ; oui, en 2019, en France, on explique à une femme enceinte de sept mois qu’elle doit travailler si elle veut vivre ; oui, en 2019, en France, etc., etc., etc.
Ce film raconte l’histoire d’un scandale, de mille scandales. De l’extrême pauvreté dans la sixième puissance mondiale ; du déclassement généralisé des classes populaires dans l’indifférence générale ; des mécanisme de culpabilisation qui viennent, en plus, alourdir le poids qui pèsent sur ces personnes. Ces scandales méritent d’être rappelés, sans relâche, d’être hurlés, chantés, écris, documentés. Ce film participe à cela. À cette nécessité de montrer les scandales, de nommer leurs responsables et de leur rappeler la honte qu’ils devraient ressentir s’ils avaient deux ronds de décence (ils n’en ont pas, alors ils envoient la troupe).
Surtout, au-delà d’être un film nécessaire, un film cathartique, un film politique, J’veux du soleil est aussi un film beau. Un film qui parle aussi, surtout, de la beauté. Celle des gens, du peuple, de l’humain, de nous en fait. Par contraste.
Car le paysage, lui, est hideux. Ruffin le note au détour d’un énième parking géant de Carrefour : des quatre-voies, des parkings, du béton, des hangars de centres-commerciaux, du béton, des ronds-points, du béton, du béton, du béton. On a tué les périphéries, on les a rendues moches, étouffantes, détestables, tout en tuant par effet miroir les villages, vidés de leurs petits commerces et de leurs services publics par l’extrême centralisation et la rationalisation à tous les étages. Il est en cela très symboliques que les gilets jaunes aient choisi les ronds-points comme lieux de rassemblement : ils sont le symbole de ce que le libéralisme appliqué à l’aménagement du territoire a fait de pire1. Des places de village, des centres-villes où l’on se croisait, où l’on partageait des instants, où l’on vivait en somme, nous sommes passés aux ronds-points, où l’on ne fait que passer, vite, consommateurs pressés d’aller ailleurs, où l’on ne se croise même plus, où l’on tourne en rond, où l’on se tourne autour en ne se rencontrant qu’à la faveur d’une queue de poisson et d’un coup de klaxon.
Et en face, les gens… et leur beauté. La plus grande force de ce film, sa plus grande réussite, c’est en fait cela : documenter la beauté des gens dans un monde hideux. Macron et sa cour s’acharnent à présenter les gilets jaunes comme incultes, grossiers, volontiers racistes, aigris alors même qu’ils ont la chance – que dis-je, le privilège ! – de vivre dans une société en marche vers le paradis libéral mondialisé. C’est bien tout le contraire qu’il faudrait voir.
Car ces gens sont beaux ; ces gens sont dignes ; ces gens ont de l’esprit… ces gens ont de l’humour, bon sang ! Dans Merci Patron !, on riait par la mise en scène de la grande arnaque de Bernard Arnault : ici, on rit tout simplement par l’humour des gens. De celui qui trouve des façons imagées de justifier le prix de la moquette ou de la vaisselle de l’Élysée ; de ce petit maire de village qui joue à « que dirais-je si j’étais face à Macron ? » ; de ce couple formé sur les ronds-points qui, au détour de leur récit romantico-contestataire, balance une insulte assez fleurie à l’égard de Macron en riant. Reconnaissons d’ailleurs l’élégance des réalisateurs de n’avoir laissé filtrer que peu de moments insultants pour Macron : gageons que les rushes en étaient bien garnies.
On se rassemble en riant ; on rit par ce qui nous rassemble. Perret et Ruffin l’ont compris : tout l’enjeu est de faire que les classes moyennes supérieures et la petite bourgeoisie (dont leur public est sans doute majoritairement constitué et dont je fais moi-même partie) prennent le parti des classes populaires plutôt que celui des classes dominantes. Ils ont déjà réussi à les faire rire avec les classes populaires : pas rire d’elles, pas rire à leurs dépends, pas rire avec une condescendance pour l’humour populo. Juste rire par cet humour partagé qui invite à l’empathie, celui qui est irrécupérable, celui qui provoque l’indignation des puissants, celui qui se perpétue toujours avec les blagues sur Carlos Ghosn au pain sec et à l’eau ou celles sur l’importation de la culture populaire du barbecue au Fouquet’s. C’est déjà beaucoup.
Documenter la beauté des gens dans un monde hideux, en terminant par cette image, celle en tête d’article : Marcel, peint par un camarade gilet-jaune au détour d’un rond-point de Dions2. Un visage qui dit tout : de la beauté du peuple, de sa dignité face aux souffrances infligées par un système inhumain, de son aspiration à des jours heureux. À du soleil, nous dit le titre.
Ce que ce film pourra faire de mieux, finalement, c’est ça : inviter les indécis de la mondialisation, les sceptiques du gilet-jaune, les frileux du populaire, à partager cette aspiration.
Cette aspiration du peuple à vouloir faire le monde à son image : beau.
-
Et c’est pas pour tout ramener à moi, mais c’est un truc qui m’obsède aussi. À tel point que j’y ai dédié un passage dans mon roman d’aventure fantastico-sociale (chapitre 14) : « Un lieu à l’architecture violemment futuriste, aseptisé et très exactement semblable à mille autres […]. Une autre métastase du cancer qui rongeait chaque campagne, chaque proche périphérie des villes… Cette uniformisation totalitaire du territoire : des centre-villes gentrifiés, des petits commerces désertés, des banlieues-dortoirs mises sur la touche et des zones commerciales artificielles qui poussaient comme des verrues, défigurant de leur architecture de mort ce qui restait de réserves naturelles dans le monde. La mort des cultures, la mort des patrimoines locaux, magnifiées dans un bel écrin de marketing puant et conquérant. » ↩
-
Vous pouvez lire l’histoire du portrait sur Fakir. ↩

Les articles inclassables, vous trouverez de tout dans cette catégorie : des critiques, des chroniques, de purs délires… c'est la catégorie fourre-tout !
Autres articles liés :
Soutenir
Ce blog est publié sous licence libre, il est librement copiable, partageable, modifiable et réutilisable. Il est gratuit car soutenu par un financement participatif permanent. Sans inscription, vous pouvez très simplement participer à débloquer des paliers supplémentaires :
Pour le mois prochain (avril 2026), 120 € ont été récoltés, débloquant 1 palier sur 12 :
Pour la saison en cours (2025-2026), 4600 € ont été récoltés, débloquant 0 méta-palier sur 3 :
Note : pour plus d'informations sur les paliers et méta-paliers, voir la page crowdfunding.